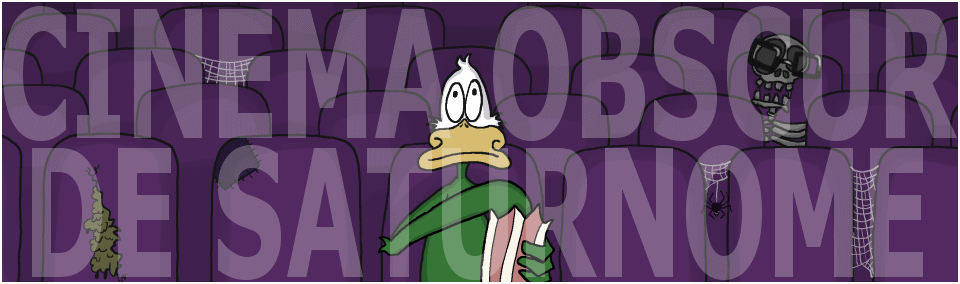Un film d'Artemio Marquez
Philippines, 1966
L'organisation CLAW, dirigée vraisemblablement par un cousin de Fu Man Chu, complet avec le pouvoir de tirer des éclairs du bout de ses doigts, lance un ultimatum de 5 jours à une union de pays asiatiques et européens de se soumettre à leur autorité sans quoi une bonne partie de la terre sera anéantie. Pour prouver son point, le cousin de Fu Man Chu présente à ces dirigeants un clip mélangeant des archives de vieux tests nucléaires et des archives d'un petit débordement de rivière, ce qui terrifie complètement tout le monde. Le danger de l'organisation CLAW est tellement grand et jamais vu qu'il faut faire appel à James Bond ET Batman. C'est grave. Petit problème cependant : Nos deux héros ne s'aiment pas beaucoup...
James Bond et Batman sont joués par Dolphy, un acteur comique très célèbre alors. Les choses se compliquent par contre : l'identité secrète de Batman n'est plus Bruce Wayne ici mais ... Dolphy, qui joue donc son propre rôle quand Batman est sans déguisement. Beaucoup plus troublant cependant est Robin ; même sans son déguisement, les gens continuent de l’appeler Robin, comme si il était évident qu'il était le justicier masqué même sans déguisement, et que cela ne dérange personne.
On a également droit à deux des ennemis jurés de Batman, Joker et le Pingouin. Si ce dernier ressemble un peu à l'original, Joker est complètement transformé en punk à lunettes fumées qui a perdu une main, et qui tient dans l'autre un fusil gigantesque.
La présence de Dolphy fait qu'il s'agit d'une comédie. Le côté ridicule semble assumé, mais les sketchs comiques sont plutôt catastrophiques. Les dialogues sont mauvais, mais l'acteur s'en sort par son talent comique qui est réel, grâce à quelques petits détails qu'il ajoute dans son jeu, comme nettoyer ses mains sur la cape de Robin après avoir mangé. Heureusement, le film a davantage de scènes d'actions (le film en est presque saturé) ou dramatiques qui sont au final les véritables scènes comiques. Le bas budget, le scénario sans queue ni tête qu'on oublie quelque part au milieu du film, l'humour enfantin ont de quoi amuser. L'intérêt principal évidemment est de voir ces personnages bien connus parodiés de la sorte, mais finalement on en retire davantage.
Le film s'efforce d'être de bonne facture, avec des mouvements de caméra, des cadrages stylés - parfois à l'excès, je pense à une scène de combat où un vilain tombe visiblement par accident sur la caméra, ce qui manque de faire trébucher le caméraman - mais le montage de ces scènes est quasiment faite au hasard, en étirant des scènes inutiles un peu trop longtemps ou en coupant trop court ailleurs. Le combat final du film, ou entre autre s'oppose James Bond et le Pingouin dans un lieu très propice à un climax de film James Bond et complet avec le thème de Batman qui joue (avec un solo d'orgue déchaîné!) est... très long. Et malgré qu'il alterne entre trois combats simultanés, demeure plat. Mais heureusement rien dans ce film dépasse la barre qui mène à l'ennui, et les quelques moments de vide durent juste assez longtemps pour qu'on se demande, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? ...Un épisode très très étrange du vieux Batman, peut-être, et encore.
Une petite note à propos du film suivant celui-ci dans la série des Batman des Philippines. Batman Fights Dracula (1967) était le premier en couleur de la série, tourné dans un autre studio avec une équipe et des acteurs complètement différents. Malheureusement le film est aujourd'hui considéré perdu, un rappel que les films disparus ne se limite pas qu'au cinéma muet et les premiers films parlants. James Batman quant à lui a survécu, mais en très mauvais état.