
Un film de Per Åhlin
Suède, 1989
V.F. : Voyage à Melonia


Prospero est un magicien qui crée la tempête du début de l'histoire afin de protéger son île, Melonia, de possibles envahisseurs. À bord, en dehors du capitaine, le timonier et une cuisinière, s'y trouve Ferdinand, un jeune esclave de l'île industrielle de Plutonia, ainsi que Slug et Slagg, patrons d'une usine d'armements. Le reste des personnages nous vient de La tempête, comme Ariel, Cabelan et Miranda. Il y a également un certain William, sorte de petit chien/peluche passionné de poésie et de théâtre et qui rend les choses très bizarres lorsqu'il trouve La tempête de Shakespeare et décide de la mettre en scène. Tout ces personnages sont bien établis et intéressants, c'est le genre de film avec une distribution d'ensemble où l'on peut avoir un personnage favori (mais difficile de choisir autrement que Cabelan et sa tête en légumes, quand même).
Melonia est une île paradisiaque, magique, à la végétation luxuriante et où il fait bon vivre. Plutonia est une île où il ne reste rien qui n'est pas fabrication humaine et est pleine détérioration. Le contraste est clair ; y a des gentils, y a des méchants, c'est un peu naïf. Hors, même si ce n'est pas assez poussé (encore moins dans le doublage français, voir plus bas), Prospero aussi n'est pas blanc comme neige, utilisant la magie de l'île ainsi que ses habitants à sa guise. Il reste qu'avec une telle dichotomie le film tente de pousser très fortement un message pro-environnementaliste simple qui n'en fait pas un film gagnant en subtilité avec un public vieillissant.


Ce qu'il garde par contre c'est un univers non sans charmes, ses personnages variés et un style unique. Comparé à plusieurs autres long-métrages d'animation européens pré-années 90, la qualité est assez bonne (retomber sur de vieux films d'enfance de l'époque mène souvent à de mauvaises surprises! Plusieurs au Québec se souviennent d'un autre classique de l'animation suédoise, Pelle Svanslös (Peter le chat sans queue, 1981), gardez-le dans votre souvenir tel qu'il est). Le look des personnages, stylisé et un peu brouillon à la fois, ne devrait pas autant bien se prêter à l'animation alors c'est une bonne chose. L'on pardonnera l'erreur occasionnelle comme un pantalon qui change de couleurs l'espace d'une seconde. L'animation en mer, avec les bateaux qui se déplacent de façon très réaliste (il n'est pas impossible que la même technique utilisée pour les voitures dans 101 Dalmatians soit réutilisé ici, à vrai dire j'en suis même sûr) et particulièrement l'animation des vague qui est très fluide mais hautement fantaisiste est un moment fort. C'est un peu comme tout le film avait du bon comme du mauvais pour chaque aspect. La musique est à son meilleur lorsqu'elle fait penser à du Vangelis, moins lorsqu'elle fait penser au générique d'une émission d'astrologie. La végétation de Melonia est particulière et belle, mais le reste est ordinaire et aucun plan n'est à couper le souffle.
Au final c'est un film qui résiste bien à un regard adulte, même si il n'est pas du tout fait pour cela. Il y a de quoi se plaire dans une foule de détails, comparé à un Nième films d'animaux animé à l'ordinateur celui-ci offre quelque chose de différent et de plus frais, même si il manque la perfection technique. Il y a cependant des problèmes de scénario difficiles à ignorer : des personnages étant capable de TOUT faire grâce à la magie est toujours un problème...


Oh!
Mais peut-être que vous avez vu ce film dans votre jeunesse? C'est très très possible, il a été doublé en français par toutes ces voix familières de l'époque. Au Québec Voyage à Mélonia a passé à Ciné-Cadeau à quelques reprises et plus d'une personne en est nostalgique. Les différences entre la version française et la version originale sont... très grandes:

Déjà, et oui, là où la version française s'arrête... La version originale continue pendant encore plus de 10 minutes ! Plusieurs petits détails se concluent, le tout en chanson (peut-être les doubleurs n'avaient pas envie de chanter?) notamment Prospero redonne liberté également à Ariel l'oiseau.
Mais si ce n'était que ça! Presque 25 minutes sont coupées au total. Dur à dire si c'est ciné-cadeau au Québec qui en a coupé davantage ; les VHS françaises prétendent durer 97 minutes, ce qui laisse tout de même 10 minutes de plus à l'original.
L'interprétation de La Tempête de Shakespeare va plus loin, les personnages se déguisant en d'autres personnages du film:

La première nuit que passe à Mélonia Ferdinand, le jeune rescapé de Plutonia, est suivi d'un cauchemar, regardez-moi ça:


Ce cauchemar aide ensuite à établir une conversation entre Ferdinand et la fille de Prospero, Miranda. Également coupé au montage.
D'ailleurs voulez-vous une anecdote pour vos soirées mondaines? Dans la version originale, la voix de Miranda est donnée par Robyn, à l'âge de 10 ans, bien avant qu'elle ne devienne une chanteuse populaire!
Allez on continue. Ferdinand et le timonier se font donner un petite visite guidée de Melonia par Ariel à leur arrivée. Ce que vous n'avez pas vu c'est que l'île est habitée par un dragon:

un oiseau-lanterne:

Et plein d'autres créatures étranges qui laissent croire que Prospero abuse un peu de la magie de l'île.
En plus de cela, la version originale est en rimes, chose totalement perdue dans la version doublée. Cela entraîne quelques problèmes de traduction...
Bref. C'était quand même bien quand on était jeune. C'est un film qui a mieux vieilli que d'autres que l'on a vu alors.
Per Åhlin a également réalisé Dunderklumpen! (1975), un autre film qui passait fréquemment à Ciné-Cadeau... Mais je ne le retrouve pas. Tant pis...

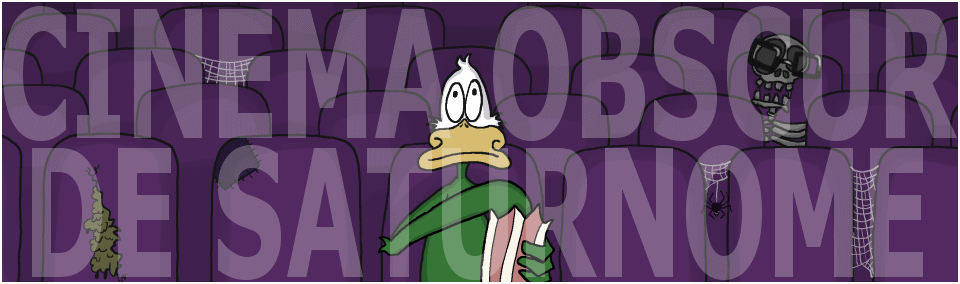







































 <
<